Pro bono publico
À l’ère des mégaspectacles, des festivals et des superproductions, la culture est-elle condamnée à se justifier par le discours économique?
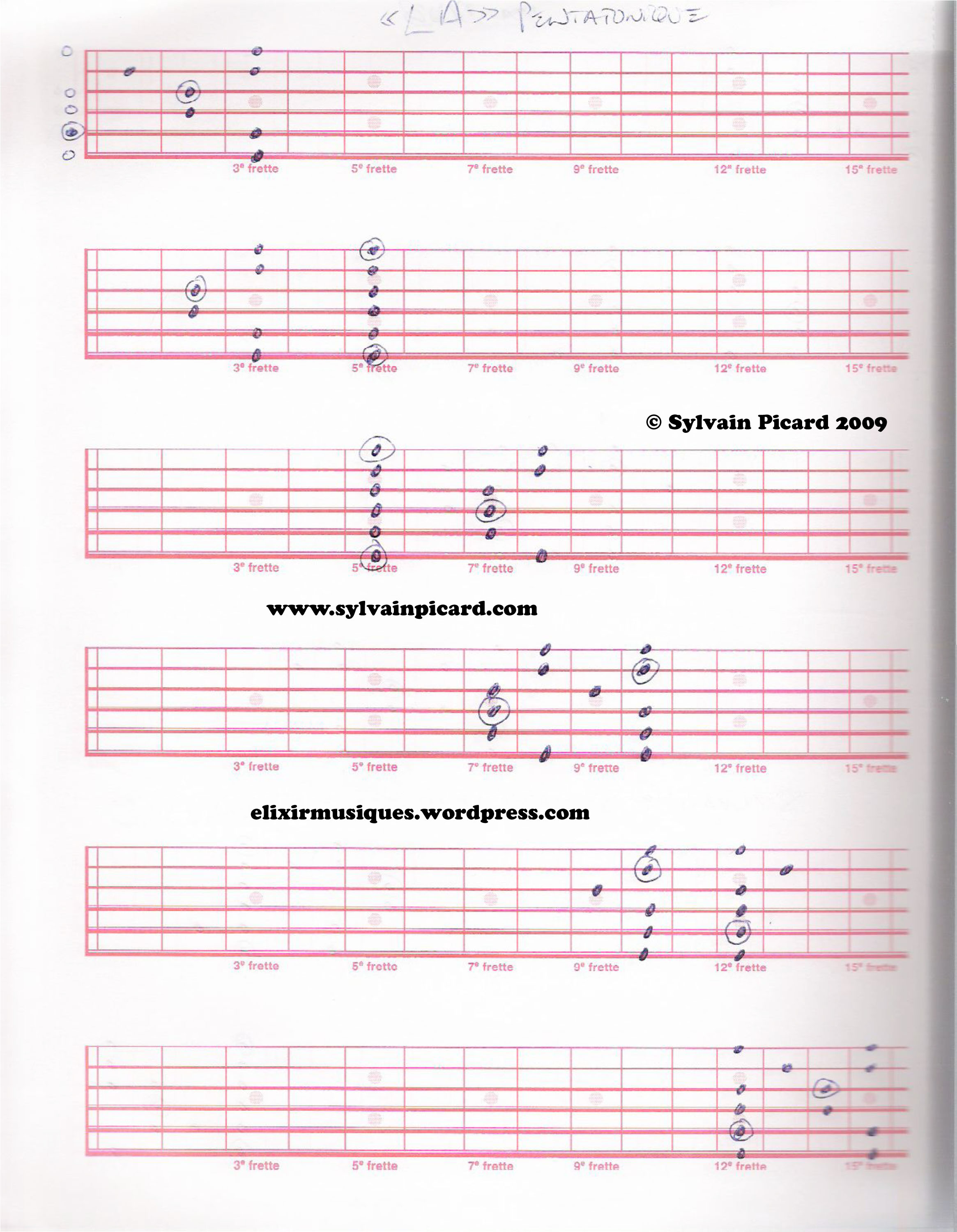
On sait ce que vaut maintenant le U2360º Tour, dont le premier des concerts du week-end était offert hier soir dans un stade spécialement érigé à Montréal: bon, pas bon, le supermégaspectacle a déjà rapporté 740 millions en revenus juste aux guichets, ce qui en fait la tournée la plus lucrative de l’histoire de la musique. L’ancien record appartenait aux Rolling Stones, qui ont engrangé à peine 660 millions avec A Bigger Bang Tour, entre 2005 et 2007. Pas fort, les papis…
Dans tous les cas, il faut ajouter les non moins lucratives recettes des produits dérivés du produit principal. Un fan dépenserait une quinzaine de belles piastres en moyenne. Ils sont 80 000 par représentation au stade youtouesque.
U2 joue pour le bien de tous, mais il ne s’active pas vraiment pro bono publico, comme disent les juristes, à titre gracieux, quoi. La musique qui adoucit les moeurs endurcit donc aussi les portefeuilles. Celui de Paul David Hewson, dit Bono, chanteur et auteur de la formation irlandaise, pèse son milliard de dollars, sans compter les profits de la présente tournée, évalués à plus du tiers des revenus.
Il n’y a pas que ça, évidemment. Le baobab du nabab de la pop cache une forêt où la culture triomphe en business pour vendre des produits plus ou moins artistiques. Même les PME et les entrepreneurs-créateurs en marge justifient leur existence (et leurs subventions) à coups de retombées économiques et de créations d’emploi. Reprenons et généralisons donc la question fondamentale à plusieurs milliers de milliards: quelle est la valeur de l’art? La culture est-elle maintenant condamnée à trouver ses justifications premières dans le marché et dans le discours économique, en glissant pour ainsi dire d’une valeur à l’autre, du sens aux sous?
La mercantilisation généralisée
«Il reste par bonheur nombre de lieux et d’acteurs qui résistent à l’emprise de ce discours d’asservissement économiste, mais il est vrai que la tendance très largement dominante est bien celle d’une mercantilisation générale des esprits et, par suite, des pratiques, répond par écrit Pierre Popovic, professeur de littérature de l’Université de Montréal, spécialiste des théories du discours. «Pour en rencontrer un exemple des plus communs, il suffit d’écouter la façon dont les invités sont présentés dans les émissions dites « culturelles » et dans les talk-shows à la radio ou à la télévision. Cela donne lieu à des exercices d’adoration extatique de ce type: « Voici X qui a vendu 15 millions d’exemplaires de son dernier album. Waouh! » ou « C’est un honneur de recevoir Y qui a conquis le coeur de centaines de milliers de lecteurs. Waouh! » Il ne faut pas s’y tromper: ce genre de propos est plus retors qu’il n’y paraît. Ils laissent et font croire que le fait d’avoir vendu énormément est en soi un critère de qualité musicale ou littéraire et qu’il y aurait dans l’énormité des chiffres de vente une manière de vertu: les acheteurs seraient allés spontanément, naturellement vers la musique de X ou les romans de Y. C’est évidemment faux. La demande est créée de toutes pièces et l’émission, dans sa forme même, fait partie intégrante du processus de fabrication du succès de X ou de Y.»
Le Français Patrick Viveret appelle «écoligion» cet enfermement dogmatique dans l’idéologie du marché. Ce système de croyances a son clergé dans les centres de recherche, les universités et les médias, certaines grosses légumes faisant la triple trempette. C’est le cas de Nathalie Elgrably-Lévy, enseignante à HEC, membre du conseil d’administration de l’Institut économique de Montréal, un think tank de droite, et chroniqueuse au Journal de Montréal (JdeM). Elle y défendait récemment l’idée que seul le marché doit décider du sort d’une oeuvre: si ça se vend, tant mieux; sinon, tant pis. Le mois dernier, l’animatrice Krista Erickson, du réseau Sun TV, a passé à la casserole la danseuse contemporaine Margie Gillis sur le thème connexe de l’absurdité des subventions à un art jugé futile et insensé.
«Comme nous avons pu le constater avec le coup monté de Krista Erickson aux dépens de Margie Gillis, la doxa utilitaire est bien ancrée chez les gens de la droite néoconservatrice, écrit au Devoir Alain Roy, fondateur et directeur de la revue culturelle L’Inconvénient, lui aussi interrogé par courriel. La question de fond dans le débat sur le financement public des arts est la suivante: est-ce que nous consentons collectivement à ce qu’une part de l’économie relève de la pure dépense et que cette pure dépense ait pour fonction de remettre en question le primat de l’économie? Question manifestement trop sophistiquée pour Krista Erickson et les gens de Sun News. On pourrait se contenter de rire de ce genre de journalisme-poubelle, mais il est quand même un peu inquiétant de savoir qu’il émane de notre PKP [Pierre Karl Péladeau, propriétaire de Sun TV et du JdeM], lequel siphonne d’ailleurs allègrement les fonds publics pour ses propres publications de supermarché.»
M. Roy explique cet emportement dans l’utilitarisme et le tout-au-marché dans le discours entourant la culture par une «réduction de l’existence vécue comme rassurante» avec des formules simples en rapport avec la réussite, la performance et le profit. «L’utilitarisme « encadre » les hommes alors que l’art, selon le mot de Rilke, a plutôt comme vocation de nous projeter dans l' »Ouvert », poursuit-il. La contemplation esthétique peut prendre la forme d’un ravissement, mais ce ravissement n’est jamais loin d’un certain vertige, d’une prise de distance face au monde qui nous apparaît alors dans sa pure contingence; et le contingent, le non-nécessaire, l’inutile, le hasard sont toujours un peu inquiétants pour les êtres de raison que nous sommes.»
La doxa économiste
M. Popovic relie plutôt cette dérive de la mercantilisation générale des esprits au double triomphe de la révolution conservatrice et du néolibéralisme, en même temps qu’à l’incapacité des discours d’opposition à défendre la culture libre et critique, leurs propres «grands récits militants» ayant disparu. «Dans de telles circonstances, la doxa économiste n’a eu aucun mal à occuper tout le terrain, et nos petites lâchetés ordinaires (je me mets dans le lot) ont fait le reste, note-t-il. Entendons bien qu’il ne s’agit pas de nier que la culture a toujours accompagné les marchands et qu’elle a besoin de ses propres marchands (des éditeurs, des diffuseurs, des artisans, etc.), mais de rappeler que la création littéraire et artistique doit être aussi libre que possible pour assumer le rôle multiple et complexe qui lui a été dévolu depuis — grosso modo — les premiers élans avant-coureurs de la Renaissance: rôle de soutien critique aux projets d’émancipation individuelle et collective, de consolation face à la souffrance, de critique des évidences conjoncturelles, de lecture inventive du monde tel qu’il va, de mise en crise des idéologies, de brouillage et d’opacification des argumentaires monologiques, etc. Les oeuvres qui en ont résulté n’ont jamais pu le faire qu’en bataillant contre des tentatives d’instrumentalisation issues de pouvoirs externes, religieux d’abord, politiques ensuite, économiques hier et aujourd’hui.»
Aucun «secteur» ne semble à l’abri. Le professeur observe les effets concrets de la dérive dans la disparition du cinéma d’auteur italien ou allemand au profit de productions commerciales, formatées, misant sur une «hystérisation des affects et des pulsions». De même, en littérature, tout ce qui n’est pas rentable semble maintenant tenu pour «pittoresque ou supprimé».
«Premièrement, on constate que l’essentiel de la couverture médiatique est consacré à ce qu’on pourrait appeler les arts spectaculaires: cinéma, cirque, musique pop, danse, théâtre, enchaîne Alain Roy. Les arts discrets, ceux qui comme la littérature ou la peinture sont abordés sur le mode du recueillement silencieux et privé, se trouvent alors marginalisés, car il n’y a sans doute rien de plus incompatible avec l’appareil médiatico-publicitaire qui carbure aux effets de masse, à l’effusion mimétique. Deuxièmement, le tout-au-marché se manifeste dans la dissolution de la littérature au sein de la catégorie du livre. En examinant les brochures publicitaires de nos grandes chaînes de librairies, il est assez triste de constater que la « vraie littérature » y est à peu près absente, délogée qu’elle est par les livres de recettes, les guides pratiques, les manuels de croissance personnelle, les biographies, les polars, les livres jeunesse, la chicklit, les harlequinades, etc.»
Ou les livres sur U2? Dans sa chanson God Part 2, on retrouve ceci: «Don’t believe in riches / But you should see where I live». Une chanson fort agréable par ailleurs, là n’est pas la question, on se comprend, la valeur du groupe se mesurant aussi de cette manière…






